 |
 |
| |
|
||
|
|
L'EGLISE SAINT- GERMAIN-L'AUXERROIS |
||||
|
Aucun document ne permet de dater avec certitude les différentes parties de l'église. La partie la plus ancienne, reste de l'église du Xe (?), est la partie gauche du mur est de la nef. Construite en pierre locale, l'église dessine un rectangle orienté, divisé en trois vaisseaux, sans transept, vaisseaux non voûtés, mais prolongés à l'est par une travée voûtée composée du clocher et sa chapelle nord, du choeur, de la chapelle sud et la petite travée qui la prolonge à l'ouest.
Si le mur ouest est percé de deux baies assez récentes,
la nef était primitivement éclairée par des fenêtres
hautes, étroites ébrasées en plein cintre, dont
deux au nord et trois au sud subsistent, les autres étant obturées.
Quatre colonnes monocylindriques ouvrent sur les bas-côtés
portant de grandes arcades brisées. Un arc triomphal donne sur
le choeur. Ce genre de nef couverte d'une charpente se rencontre souvent
aux Xle et XlIe en Ile-deFrance et en Normandie (Saint-Léger-aux-Bois
- 1083, Rhuis, ChâteauLandon - fin Xle). Flanqué de contreforts d'angle, et divisé en 3 étages, le clocher est de la fin du Xle, primitivement hors oeuvre. Construit en blocage, sauf le 3e étage, ce clocher présente un rez-de-chaussée couvert d'une voûte d'arêtes renforcée par 4 doubleaux reposant sur des colonnes engagées à chapiteaux sculptés, et percée sur les 4 côtés (au sud par le choeur, à l'ouest par un arc brisé, à l'est vers une chapelle construite avec le clocher, mais refaite en 1504). |
||||
|
||||
 Choeur et Arc triomphal - 2e moitié XIe. |
|
Le rez-de-chaussée cumule toutes les caractéristiques du XIe (telles, celles de TRAON - 1060-1070), sculpture très primitive, arcs fourrés, voûte d'arêtes, baie fortement ébrasée, impostes et tailloirs simplement chanfreinés, bases ébauchant la forme romane d'une scotie entre deux tores, et le second étage est percé d'une baie par face, et limité par une corniche à modillons sculptés de têtes grossières, de même jet. Le dernier étage en moyen appareil doit dater des années 1120-1130, avec deux baies géminées par face, brisées, à colonnes à chapiteaux sculptés de godrons stylisés, suivant la tradition des clochers romans de L'lle-de-France (StGermain-des-Prés). |
|
||||
|
Dès l'époque romane, le chevet était plat et le choeur aussi profond qu'aujourd'hui. Vers 1100, l'église se composait donc d'une nef unique charpentée, flanquée d'un clocher non terminé, avec à l'est une chapelle. A la seconde moitié du Me siècle, on reprend le choeur et construit la chapelle sud, ainsi que la petite travée qui la prolonge à l'ouest. Le choeur, de quelques années antérieur à la chapelle sud, est percé à l'est et à l'ouest, et au sud. La chapelle sud a un appareil et une voûte de même profil que le choeur, que l'on retrouve dans les chapelles rayonnantes. Au même moment, on surhausse les murs goutterots de la nef et élève une nouvelle charpente (celle que l'on voit aujourd'hui date de 1846). Ainsi vers 1160-1170, l'église était encore à nef unique, mais son développement à l'est appelait des bas-côtés. Le collatéral sud sera construit à la fin du XlIe ou au début du XIIIe siècle, comme en témoignent ses chapiteaux. Avec sa file de piles rondes, ce collatéral est pratiquement le seul témoignage à CHATENAY de l'influence de Notre-Dame de Paris. Du collatéral nord de même construction, la baie ouest semble authentique, mais le mur nord et les colonnes datent du XIXe siècle. En 1504, sont édifiés la chapelle nord à la voûte d'ogives très plate, et l'escalier au noyau encore flamboyant. Au cours des siècles, l'église de CHATENAY subit plusieurs restaurations. La dernière campagne date de 1964. Le décapage de l'enduit des murs permit de retrouver la pierre d'origine et de rouvrir les 2 grandes baies est du choeur et de la chapelle sud. Cet enduit, vraisemblablement appliqué sur murs et colonnes en 1846, recouvrait la litre funéraire du Seigneur Nicolas de Malézieu (inhumé à Châtenay le 5 mars 1727, lendemain de sa mort à Paris). La litre funéraire consistait en une bande noire décorée de blasons du défunt. Deux sont encore visibles au-dessus d'une colonne du XIIIe, au sud de la nef. |
||||
|
ÉTAPES SUPPOSÉES de L'ÉGLISE ACTUELLE MYSTÈRES que des FOUILLES ou SIMPLE SONDAGE PERMETTRAIENT PEUT-ÊTRE
D'ÉCLAIRCIR : |
PLAN ACTUEL DE L'ÉGLISE SITUANT LES DIFFÉRENTES ÉPOQUES |
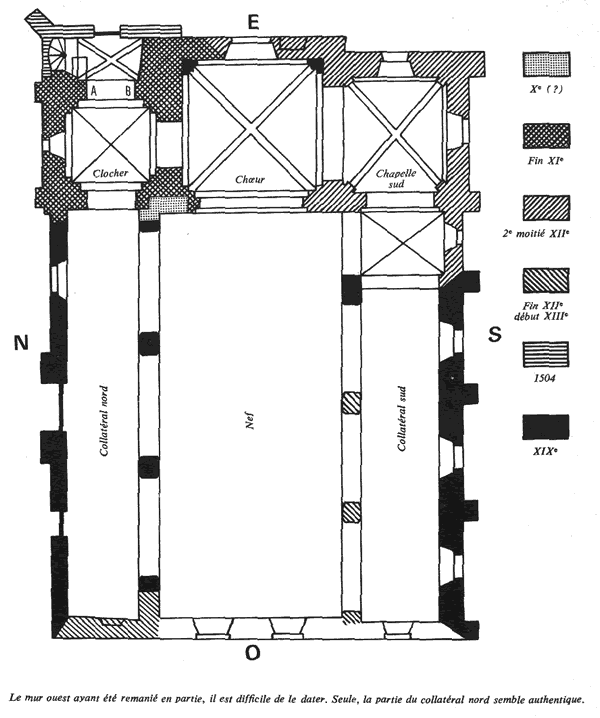 |